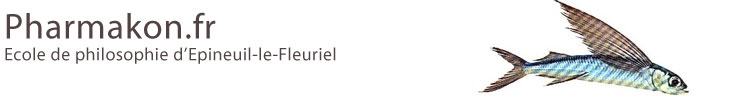Pharmacologie du virtuel.
Le numérique rêvé et ses limites.
Une version abrégée de ce texte sera présentée le 18 août 2014 à Epineuil-le-Fleuriel.
J’aimerais aujourd’hui proposer une pharmacologie du virtuel. Je dis une pharmacologie parce qu’il me semble difficile de produire dans le cadre de cette communication la pharmacologie du virtuel. Pour cela il faudrait il me semble en passer par une Critique du virtuel, au sens de Kant. J’espère démontrer, si l’en est encore besoin, toute la nécessité et toute l’importance d’un travail épistémologique de cette ampleur, lequel à mon sens reste à (re)faire. En cela, d’ailleurs, ce dont je vais vous parler s’apparenterait encore mieux à un « Programme pour une critique pharmacologique du virtuel ».
A titre indicatif, mais aussi parce que je crois cette information pertinente pour le cadre général de ma recherche, j’ajoute que j’ai tenu à construire celle-ci en suivant trois axes successifs, que j’ai empruntés à Nicandre de Colophon, le poète pharmacologue du IIème siècle avant J.C., qui organisait ainsi ses Alexipharmaka. Il m’a semblé qu’il serait bon d’ainsi affirmer l’insuffisance, dans le cadre d’une approche pharmacologique et organologique de la philosophie, du plan standard de la dissertation universitaire de philosophie tel qu’il est généralement attendu, c’est-à-dire le plan dialectique. Bien plutôt, je proposerai ici et à l’avenir un plan comprenant tout d’abord une identification généalogique du pharmakon étudié, à savoir ici la situation du concept de virtuel à notre époque. Viendra ensuite une symptomatologie organologique, comme pharmacologie négative permettant de situer ce que le premier coup du double redoublement épokhal a causé comme mécompréhension du virtuel. L’étude de cette négativité, qui représentera la majeure partie de mon propos, sera elle-même subdivisée selon deux problématiques complémentaires. Enfin, j’essaierai de proposer une thérapeia générale à travers une pharmacologie positive visant à combattre et à réduire la toxicité du pharmakon.
I Identification
Très largement diffusée, la notion de virtuel est aussi très ambiguë. La confusion qui entoure son usage rend difficile la discussion commune comme la controverse philosophique. C’est tout le mérite de Stéphane Vial, à la suite de Gilles Gaston-Granger, que d’avoir récemment contribué à remettre en lumière les facettes de cet usage, en commençant par retracer son histoire. Désireux de faire tomber un obstacle épistémologique, Vial rappelle qu’au moins trois acceptions du concept sont en vigueur.
-
La virtus philosophique et sa consistance
Chronologiquement, le mot est d’abord issu du latin médiéval virtualis et traduit la dunamis d’Aristote, c’est-à-dire l’être en puissance qu’Aristote oppose à l’être en acte, ou energeia. En acte, une chose est en train de se produire tandis qu’en puissance, elle est potentielle et n’est pas actuellement accomplie. Vial donne alors deux exemples :
Exemple 1 : Quand je ferme les yeux, la vue existe en moi en puissance (c’est-à-dire virtuellement) tandis que lorsque je les ouvre, elle existe en acte (c’est-à-dire actuellement).1
Exemple 2 : Dans une compétition sportive, lorsqu’un athlète qui fait course en tête n’a pas encore franchi la ligne d’arrivée, on dit de lui qu’il est, à cet instant précis, « médaille d’or virtuelle » : par là, on veut dire que sa domination […], parce qu’elle n’est pas encore accomplie, n’est pas encore pleinement manifestée ou phénoménalisée.2
Partant de là, Vial présente la virtualité comme un
régime ontologique, une manière particulière d’être réel, celle qui consiste, en deux mots, à exister sans se manifester.3
Arrêtons-nous sur cette définition. Ce que Vial appelle ici « régime ontologique » correspond en fait à ce que tout au long de ses écrits il va plutôt nommer « ontophanie », c’est-à-dire une conception phénoménologique disons « intégriste » de l’ontologie selon laquelle dire ce qu’est une chose revient à dire comment elle apparaît. C’est la raison pour laquelle Vial prend l’exemple de la vue pour différencier le virtuel de l’actuel. Et en effet, comme nous le verrons tout à l’heure, le gros de son étude va consister à étudier le « phénomène numérique » à propos duquel il s’agira en fin de compte de produire une sorte de table des catégories. Or, sans pour autant rejeter en bloc l’approche ontophanique de Vial, il me semble dès à présent nécessaire de désavouer sa définition de la virtualité pour ceci qu’elle est trop réductrice et qu’elle me paraît reposer sur une confusion.
La confusion en question porte sur le mot « exister ». Il faut le dire d’emblée, je soutiendrai ici la thèse pas nécessairement originale, mais en tout cas incompatible avec la théorie de Vial, selon laquelle le virtuel philosophique, ça n’existe pas. C’est quelque chose qui consiste. A se contenter d’observer et de regarder, Vial ne permet pas de penser le virtuel autrement que comme une occultation et l’actuel comme une apparition. Or, l’approche ontophanique, comme nous le montrera une clinique des catégories du phénomène numérique proposées par Vial, est insuffisante pour comprendre la dimension organologique du virtuel numérique comme pour englober les enjeux du couple conceptuel virtuel/actuel dans le domaine philosophique.
C’est pour cela que je me réfèrerai à ce couple en des termes hérités de Husserl, Simondon, Deleuze et Stiegler et qualifierai plutôt la virtualité de régime ontogénétique, manière particulière d’être réel, celle qui revient à consister, à évoluer sur un plan de consistance, à baigner dans ce que Simondon appelle le pré-individuel et que tout à la fois rejoint le transindividuel. Le virtuel, dirai-je donc, c’est ce qui devient par l’actualisation d’un potentiel, c’est-à-dire par son individuation, et la virtualité, c’est la condition de tout devenir : physique, vital, psycho-social et technique.
Du point de vue de Vial, il ne s’agit pas de concevoir la virtualité comme mode du devenir mais plutôt comme un certain mode de l’apparaître, c’est ce que montrent ses deux exemples, lesquels relèvent en fait d’une confusion sur la nature de l’actualisation. Dans l’exemple 1, ce qui est virtuel, la vue, ne s’actualisera pas parce que l’on m’aura vu voir, mais parce que j’aurai usé la vue, parce que j’aurai individué l’être-capable-de-voir et le voir. Dans l’exemple 2, ce qui est virtuel, la victoire, ne s’actualisera pas parce qu’elle sera flagrante mais parce qu’il y aura eu un changement d’état : le coureur sera passé de compétiteur à victorieux, il aura usé, il aura individué la victoire, comme signification. Ce qu’il faut bien voir, c’est que le régime ontogénétique de la virtualité donne à comprendre l’individuation d’une signification tandis que l’approche ontophanique ne permet que d’apprécier l’état manifesté d’une chose. La critique très simondonienne que j’adresserais donc à l’ontophanie de Vial, c’est qu’elle s’intéresse à l’individu manifesté plutôt qu’au processus de son individuation.
Ajoutons à ces considérations qu’il faut éviter de voir dans le virtuel « l’opposé de la réalité »4 tout comme le prétendait déjà Gilles Deleuze, dans Différence et Répétition5, à la suite du Bergson de Matière et mémoire. Chez Deleuze, en effet, c’est le possible qui s’oppose au réel, tandis que le virtuel est en rapport non pas simplement d’opposition à l’actuel mais plutôt de composition et d’entre-participation. Si par « réel », nous nous accordons pour entendre « ce qui doit être pris en compte, ce qui doit être interprété, ce qui relève d’une éthique », alors le virtuel philosophique est on ne peut plus réel ; et si l’on tenait absolument à trouver dans ce qui est « réel » une dimension matérielle, alors on serait servi puisque le virtuel de la consistance, c’est ce qui repose sur des hypomnémata, des rétentions tertiaires, et en fin de compte, sur le processus de grammatisation, comme le montre Husserl dans L’origine de la géométrie en écrivant que c’est
grâce au langage et à l’immense étendue de ses consignations, comme communications virtuelles, que l’horizon d’humanité peut être celui d’une infinité ouverte, comme il l’est toujours pour les hommes.6
-
L’image virtuelle et la phénoménotechnique
Deux autres usages techniques du concept sont passés en revue par Vial.
Tout d’abord, l’usage scientifique qui consiste à dire qu’une image virtuelle est celle qui est artificiellement construite et invisible en dehors du cadre phénoménal garanti par l’appareil technique la produisant. Vial voit là le principe de la phénoménotechnique de Bachelard, ce qui l’amène à écrire très justement que « le virtuel de l’opticien n’est pas la même chose que le virtuel du philosophe »7.
En effet, le premier désigne ce qui n’existe réellement qu’au travers de sa manifestation, laquelle n’est rendue possible que par le biais d’une technique. Par exemple le microscope manifeste le microbe. Celui-ci n’existe qu’au travers de cet appareillage technique. Au contraire, nous l’avons dit, le virtuel philosophique serait plutôt ce qui consiste et n’existe donc pas.
On voit bien que la relation compositionnelle du virtuel à l’actuel n’aurait pas de sens dans la phénoménotechnique : le virtuel que Vial dit « optique » se manifeste en tant que virtuel ; il ne s’actualise jamais, car il n’est pas une consistance mais une construction. Le virtuel de la phénoménotechnique n’est pas un potentiel, c’est une apparition. La virtualis au sens classique double le réel actualisé d’un réel virtualisé, tandis que, comme l’écrit Bachelard : « la puissance de variation phénoménotechnique est une instance nouvelle de la philosophie. Elle double le réel par le réalisé. »8
-
Le virtuel informatique et la simulation
Enfin, Vial propose une définition de l’usage du mot virtuel rapporté à l’informatique :
On appelle virtuel n’importe quel processus capable, grâce à des techniques de programmation, de simuler un comportement numérique.9
Le virtuel informatique, comme celui de la phénoménotechnique, relève donc de l’artificiel. La différence tient à ce qu’au lieu de reposer « sur des techniques de rayonnement lumineux », le virtuel informatique se fonde sur
des techniques de programmation informatique, c’est-à-dire sur des algorithmes et des langages. Le virtuel informatique, c’est donc le simulationnel.10
En cela, et en ce que la simulation repose sur de la technique, le virtuel informatique ne s’oppose pas non plus au réel, il est constitué par la matérialité. Pour autant, l’usage commun du mot « virtuel » appliqué aux outils informatiques tend à suggérer une dimension immatérielle des environnements simulés. Afin d’éviter cette erreur, Vial suggère que l’on garde toujours à l’esprit que le virtuel informatique correspond essentiellement à ce qui est « informatiquement simulé »11. Il rappelle par ailleurs que si l’on a voulu faire du virtuel la caractéristique essentielle du numérique, il ne faut pas le confondre avec la réalité virtuelle qui, comme nous le verrons tout à l’heure, n’est pas présente dans tous les aspects du numérique.
Résumons-nous. Tel qu’il se présente à l’étude, le concept de virtuel s’apparente à deux familles d’usages bien différentes. Pour les philosophes, il est ce qui consiste et dont l’actualisation relève de l’individuation d’un potentiel. Pour la technoscience, il est soit la construction fondée sur une phénoménotechnique d’une manifestation de phénomènes invisibles à l’œil nu, soit la simulation basée sur une algorithmique d’un comportement programmé. Dans tous les cas, le virtuel est une réalité, mais à la différence du virtuel construit de la technique, le virtuel consistant des philosophes balance entre sa virtualité et un régime d’actualisation.
II Symptomatologie organologique :
Introduction : Le virtuel et l’éthique
Il est peut-être bon de le rappeler en préambule : la pharmacologie philosophique n’est pas seulement une méthode d’herméneutique critique : elle est aussi, en son principe, une méthode éthique : elle permet d’étudier un objet technique, tel le concept de « virtuel » et, par-delà les limites que la fonction critique de cette pharmacologie peut établir à l’ontogenèse de ce pharmakon, sa fonction éthique en établit une déontogenèse : elle décrète ce qui en lui tient du remède et ce qui tient du poison.
La symptomatologie que je vais présenter relèvera donc du jugement de valeur. Je vais me demander en quoi la confrontation des considérations générales évoquées ci-avant et leur application dans les domaines théorique, esthétique et socio-économique me permettent de douter de l’éthique inhérente aux usages du concept de « virtuel ». Dans le cadre de cet exposé, je n’étudierai le virtuel que sous son aspect informatique : celui de la simulation, à travers lequel certains se rêvent étrangers au monde, hors de lui, désaffectés, tandis que d’autres en font le rêve de leur détachement de la finitude, physique et rétentionnelle que leur impose leur corps. Ces rêves, comme symptômes, seront l’occasion d’avancer quelques limites au virtuel. Car le rêve, sans rien lui retirer de nécessité et de beauté, c’est ce qui appelle une interprétation, c’est-à-dire un jugement.
1)Le virtuel numérique et la métaphysique de l’irréel
Stéphane Vial nous a mis en garde contre un premier symptôme de la toxicité du virtuel informatique ; celui qui transparait le plus couramment et le plus explicitement sans doute. Ce symptôme tient dans le rêve d’un monde à part, dans l’idée que le numérique serait constitué de part en part d’irréalité. Cette vision chimérique du virtuel de la simulation prend ses racines dans les premières théories du numérique telles qu’elles apparurent au début des années 90 et notamment à travers les ouvrages de Philippe Quéau, à la suite desquels s’est répandue dans une large part des discussions en sciences humaines comme dans l’usage courant cette idée d’une opposition entre le réel et le virtuel. Entre d’une part le monde matériellement concret des lois de la nature et des lois des hommes et d’autre part la simulation informatique comme un autre monde, une réalité différente : virtuelle, c’est-à-dire irréelle.
Ce que Vial appelle une « métaphysique de l’irréel » peut encore être observé aujourd’hui dans l’opposition naïve et apparemment inoffensive entre « online » et « IRL ». C’est ainsi en effet que l’usager du web fait la différence entre ce qu’il vit lorsqu’il est connecté12 et ce qu’il fait IRL, In Real Life, dans la vraie vie. On retrouve dans bien d’autres aspects quotidiens de notre rapport au virtuel de la simulation informatique cette distinction entre la vraie vie et ce qu’il faut bien supposer être une hypothétique fausse vie, entre une réalité et une surréalité, voire entre une vie qui compterait et une autre qui ne compterait pas vraiment.
- Le platonisme du virtuel numérique et l’oubli de la matérialité
Aux yeux de Philippe Quéau, le virtuel de la simulation est ce qui nous donne à voir des réalités intermédiaires :
Les images tridimensionnelles “virtuelles” ne sont pas des représentations analogiques d’une réalité déjà existante, ce sont des simulations numériques de réalités nouvelles. Ces simulations sont purement symboliques, et ne peuvent pas être considérées comme des phénomènes représentant une véritable réalité, mais plutôt comme des fenêtres artificielles nous donnant accès à un monde intermédiaire, au sens de Platon, à un univers d’êtres de raison, au sens d’Aristote.13
On le voit bien, pour Quéau, la réalité des êtres virtuels est en opposition avec la réalité au sens où nous l’entendons au quotidien. Il s’agit pour lui de voir dans cette nouvelle réalité un équivalent numérique du ciel des Idées de Platon : le numérique nous permettrait de faire apparaitre et donc de contempler les Idées. Vial montre très bien que cette conception métaphysique du virtuel numérique tient à une tentative « de fusionner l’acception informatique du terme (simulationnel) avec son acception philosophique (potentiel). »14 Ainsi peut-on replonger allègrement dans le platonisme le plus béat devant un nouvel outre-monde dont les habitants seront ontologiquement distingués de ceux du monde réel. Ainsi peut-on dédouaner les êtres métaphysiques peuplant ce monde virtuel de toute responsabilité. Ainsi, enfin, peut-on oublier que le virtuel simulationnel et son outre-monde reposent sur une matérialité tout ce qu’il y a de plus concret. Oubli que Jonathan Crary résume ainsi :
Beaucoup, parmi ceux qui célèbrent le potentiel transformateur des réseaux de communication, font l’impasse sur les formes de travail opprimées et les ravages environnementaux dont dépendent en réalité leurs fantasmes de virtualité et de dématérialisation.15
La métaphysique de l’irréel, plutôt que de penser le virtuel numérique dans sa matérialité ou son hypermatérialité, préfère l’extraire du réel tout en lui conservant un autre type de réalité, une réalité virtuelle.
- La réalité virtuelle, l’immersion et l’oubli de l’éthique
Or, c’est là un autre symptôme : on a souvent assimilé le numérique à une réalité virtuelle sans toujours définir ce que peuvent signifier ces mots. D’abord, il faut bien le dire, la confrontation à l’informatique et au numérique nous met bel et bien en rapport avec des réalités virtuelles, au pluriel, c’est-à-dire avec des éléments réels informatiquement simulés, comme par exemple la simulation virtuelle d’environnements de travail, tel le logiciel de traitement de texte. Pour autant, ces éléments virtuels ne sont pas superposables à ce qui mérite le nom de réalité virtuelle, ou de monde virtuel. Ceux-ci seraient plutôt selon Vial des univers simulés dans lesquels
l’utilisateur peut lui-même s’instancier comme être virtuel (par exemple sous la forme d’un personnage). 16
Il est bien évident qu’en aucune manière le traitement de texte ne remplit ces conditions : les interfaces numériques de ce type fournissent à l’usager une certaine virtualité mais pas forcément l’équivalent d’une réalité virtuelle.
Dans un article paru en 200817, le phénoménologue allemand Lambert Wiesing propose d’envisager les mondes virtuels en s’accordant avec la conception informatique du virtuel, celle de l’informatiquement simulé. Pour lui, il y a bien deux types de réalité : celle du monde palpable et celle des mondes virtuels, mais à la différence de Quéau, Wiesing n’envisage pas la réalité virtuelle comme un ciel platonicien, il s’agit simplement d’une construction. Or, ces mondes virtuels simulés n’ont rien du surréel, du supra-réel ou de l’irréel :
Dans la réalité virtuelle d’une simulation digitale, l’observateur ne peut pas disposer librement des objets imagés, mais il entre en interaction avec eux. Il ne peut plus déterminer que de manière limitée le mouvement de la chose montrée en image car, bien qu’il ne s’agisse de rien d’autre que d’une chose constituée de pure visibilité, elle possède pourtant – de manière simulée justement – des qualités matérielles, et elle obéit ainsi à une physique artificielle. […] L’objet imagé désolidarisé des lois de la physique est artificiellement matérialisé, et devient ainsi en apparence une chose physique, bien qu’il ne le soit pas et ne puisse jamais l’être, puisqu’il restera toujours un objet imagé. On devrait réserver le concept de réalité virtuelle, qui est aujourd’hui employé de manière inflationniste, exclusivement à ce phénomène tout à fait spécifique.18
Précisant sa pensée, Wiesing propose de distinguer ces mondes virtuels en deux catégories : ceux qui sont immersifs et ceux qui ne le sont pas. Un jeu vidéo, par exemple, est un monde virtuel qui n’est pas forcément immersif. Pour qu’il le soit, il faut que le joueur confonde des éléments réels informatiquement simulés, perçus dans son expérience de jeu, avec des éléments réels tels qu’ils apparaissent dans la réalité tangible. Cette confusion tient notamment à l’usage du casque de réalité virtuelle, ou HMD, pour Head Mounted Display, par le biais duquel « aucun mouvement de la tête ne permet à l’observateur de porter son regard hors de l’image, hors d’un cadre. »
Mais le jeu vidéo n’est pas le seul domaine du virtuel numérique concerné par le phénomène de l’immersion et le problème se pose à nouveaux frais lorsque l’environnement immersif relève d’un autre domaine, par exemple celui du pilotage des drones de l’armée américaine. Il ne s’agit plus alors d’un jeu vidéo, mais le pilote est tout de même projeté dans une réalité virtuelle, immersive ou non selon qu’il pilote avec un HMD ou face à un écran en deux dimensions. En un sens le pilote du drone pourrait échapper à l’illusion de surréalité du jeu vidéo dans la mesure où la physique simulée par ordinateur dans laquelle il évolue est strictement la même que celle à laquelle le quotidien l’a habitué. Mais d’un autre côté, il peut aisément succomber à l’illusion du surréel du simple fait qu’il pilote un objet volant.
Grégoire Chamayou a très bien montré dans sa « Théorie du Drone » que beaucoup d’autres aspects de sa condition pouvaient amener un pilote à ressentir un fort « sentiment d’invulnérabilité »19 et l’empêcher de faire preuve de discernement. Par exemple, il ne peut avoir accès à la représentation virtuelle de ses cibles potentielles qu’au travers d’une distance telle qu’il lui est impossible de réellement distinguer les visages et le détail des lieux observés, lesquels lui apparaissent de toute manière avec un délai de « latence du signal »20. Perdant son aptitude à distinguer le détail et incapable de simultanéité entre son voir et son agir, le pilote perd ce que Jonathan Crary appelle sa « capacité à faire le lien entre des distinctions visuelles et des évaluations sociales et éthiques ».21
D’autre part, le pilote observe son terrain de chasse continuellement et en temps réel, ce qui équivaut à de nombreuses heures passées devant son écran durant lesquelles il doit faire corps avec ce lieu qui est virtuellement présent devant ses yeux, qui existe quelque part (en Asie Centrale) mais ne lui apparait que par le biais d’une phénoménotechnique héritière du microscope. Le pilote est désinvesti en tant que soldat, il devient un instrument du maintien de l’ordre par la violence et les conditions dans lesquelles il est placé pour accomplir sa tâche, qui est autant un devoir de surveillance qu’un devoir d’assassinat, l’amènent à considérer son geste comme relevant davantage du jeu vidéo (où l’on tue d’un clic sans remord) que de la responsabilité morale. Chamayou parle à ce sujet d’une « virtualisation de la conscience de l’homicide »22 et montre quelles conséquences cette désaffection peut avoir sur la psychè des pilotes.
- Le virtuel numérique, comme réalité, et l’oubli de l’herméneutique
Malgré tout, ces mondes virtuels, s’ils sont condamnés à l’irréalité dans l’opinion collective, ne le sont en fait que par contumace : au premier chef, ce rêve d’irréalité ne touche que peu de personnes. Ce sont les joueurs qui sont les premiers concernés, et la croyance en une irréalité ou une surréalité du monde virtuel ne peut qu’être restreinte à des cas pathologiques au sein de la large communauté des joueurs, lesquels savent, pour la plupart, de quoi il retourne.
C’est en fait un processus bien plus généralisé qui découle de la confusion devenue plus diffuse et donc plus sournoise ces cinq ou dix dernières années entre la représentation informatiquement simulée et le supposément « réel ». Nous nous sommes habitués à dépasser les conceptions primitives que nous nous faisions du virtuel numérique, du web et de ce qui fut appelé le « cyberespace. » Comme le dit très bien Stéphane Vial,
S’envoyer des messages, faire des achats en ligne, échanger sur Twitter, tout cela ne résonne plus pour nous comme des pratiques relevant d’un cyberespace [mais plutôt] comme des pratiques relevant du même espace que l’espace du monde. […] Nous n’avons plus le sentiment d’être projetés dans des « mondes virtuels » mais plutôt de vivre avec des « interfaces numériques ».23
Loin donc de faire du virtuel une réalité séparée de la nôtre, nous avons appris à en faire notre réalité, notre monde et « à considérer comme des choses les choses qui apparaissent sur nos écrans »24. On pourrait dire alors que la conception commune du virtuel numérique tend à se rapprocher de la conception phénoménotechnique du virtuel : ce que l’on observe grâce au numérique n’est plus une irréalité simulée, mais bien plutôt une réalité construite.
Ceci m’amènerait alors à deux imprécations. D’abord, il faudrait ne pas oublier que ce qui est observé est simulé, et particulièrement quand on se met en rapport à des mondes virtuels, sous peine de retomber dans un rêve faisant de la simulation immersive un simulacre ou même l’équivalent de la réalité tangible ; ensuite il faudrait garder à l’esprit que ce qui est observé est construit, et ceci afin d’éviter de prendre pour acquises les choses vues sur l’écran, qu’il s’agisse de design, de discours, ou d’images. On évitera ainsi d’oublier que le design le plus communément proposé n’est pas forcément le meilleur, que Wikipédia ne dit pas forcément la vérité, ou encore que les photos peuvent être retouchées. Cette sortie progressive de la métaphysique de l’irréel ne doit pas, en définitive, s’accompagner d’une idolâtrie du réel informatiquement simulé dans la mesure où tout ce qui est réel, tout ce qui se présente face à nous, doit être pris dans une herméneutique, c’est-à-dire dans un processus d’assimilation éthico-technique et dans une pharmacologie.
Comme me le faisait récemment remarquer Nicolas Sauret, on pourrait être tenté de considérer que
le numérique et plus particulièrement le web, n’est pas seulement une écriture du monde, mais devient de plus en plus le monde lui-même, c’est-à-dire le lieu-même de l’action, de l’expérimentation, de la communication, et bien sûr de l’inscription.
Et en effet une ressource numérique n’est pas seulement représentée virtuellement par la machine. Il y a une addition certaine d’information à cette ressource, par exemple des informations relatives à sa localisation, sa mise en relation avec d’autres ressources, son annotation, etc. Il y a donc dans le virtuel numérique bien davantage qu’une possibilité d’observer les choses par la simulation : cette seule observation suffit à modifier les choses, lesquelles deviennent au passage nos choses, celles avec lesquelles nous faisons monde.
Eviter de tomber dans le piège de l’irréel comme dans celui de l’impensé, dans une société où règne ce que Jonathan Crary appelle « l’exigence d’immersion obligatoire 24/7 »25 c’est alors nous souvenir que les représentations de ressources que nous voyons à l’écran « sont d’abord du langage. »26 Philippe Quéau disait ainsi fort justement que « la nature profonde du virtuel est de l’ordre de l’écriture »27. Tout ce qui nous apparait d’un phénomène numérique est issu, en dernière instance, d’un programme, c’est-à-dire de lignes de code, d’un langage de programmation, d’une écriture. En tant que telle, la représentation offerte par le virtuel numérique relève du discours, et donc de l’interprétation, et du jugement.
2)Le virtuel numérique et la métaphysique du possible
Si Stéphane Vial nous aide à comprendre le dépassement déjà largement opéré de la métaphysique de l’irréel du virtuel numérique, son approche critique non-pharmacologique l’empêche cependant de voir le risque de l’oubli herméneutique découlant de l’assimilation du virtuel au monde. Qui plus est, sa technophilie l’amène à sombrer lui-même dans une métaphysique du possible :
Plutôt que de succomber à la rêverie du virtuel, qui conduirait à envisager la sociabilité en ligne comme plus ou moins irréelle, il faut simplement accepter l’idée que nos modalités d’interaction sociale ont été, grâce aux technologies numériques, augmentées de nouvelles possibilités opérationnelles, sans que cela n’annule ou remplace les possibilités précédentes.28
Bien plutôt observée comme un pharmakon, la technologie numérique apparaît certes offrir de nouvelles « possibilités opérationnelles » mais elle n’en reste pas moins source de nombreux leurres. Croire qu’avec le numérique, tout est possible n’est qu’une manière de prolonger la métaphysique de l’irréel : on se rêve dépourvu de matière, flottant dans un éther de données, insoumis à la finitude et on croit échapper à l’intermittence noétique, c’est-à-dire que l’on se croit capable d’être toujours en acte.
- Le principe de réversibilité
Or c’est exactement cette illusion que l’on trouve chez Stéphane Vial. Dans sa thèse de doctorat, récemment publiée sous le titre « L’être et l’écran », et dont le cinquième chapitre se propose de présenter les onze caractères essentiels de son « ontophanie numérique », le huitième de ces caractères est ainsi présenté :
L’une des modalités ontophaniques les plus fascinantes que le phénomène numérique introduit dans notre expérience-du-monde, c’est précisément la possibilité de revenir en arrière. Non pas simplement comme au cinéma, lorsqu’on rembobine la pellicule pour revoir une scène qui sera mécaniquement et invariablement la même. Mais plutôt comme dans un jeu vidéo, lorsqu’on revient à une étape précédente pour « reprendre la partie » et qu’on peut alors inventer interactivement de nouveaux scénarios de jeu.29
En fait ce qu’évoque ici Vial, ce n’est pas à proprement parler le try again, à savoir la possibilité dans un jeu vidéo de refaire une partie : par exemple si vous jouez à Tetris et que vos briques atteignent le haut de l’écran, vous aurez perdu la partie et pourrez la recommencer ; elle sera entièrement différente. Ceci ne diffère en rien d’une partie de réussite avec des cartes à jouer. Ce dont parle Vial, à travers la « Philosophie des jeux vidéo » de Mathieu Triclot, qu’il cite abondamment, c’est cette possibilité de reprendre une partie au point où on en était resté après une sauvegarde de son progrès. Dans un jeu classique comme Tomb Raider, si vous reprenez une partie après avoir chuté d’une falaise, vous devrez néanmoins, par une série ou une autre d’acrobaties, amener Lara Croft d’un point A à un point B.
Qu’est-ce qui peut bien alors paraître si révolutionnaire dans ce principe qui, après tout, semble rejoindre celui de la réussite et de Tetris ? Certes, une liberté est laissée au joueur de choisir parmi deux ou trois voies le conduisant à son but, mais cette liberté est limitée par ce nombre réduit de choix possibles. Qui plus est, reprendre la partie après une défaite pour réessayer d’atteindre le point B laisse tout de même peu de place à l’invention de « nouveaux scénarios de jeu ». A vrai dire, la réussite semble a priori laisser plus de liberté au joueur en ceci qu’entre deux parties, les données du problème auront changé, tandis qu’en reprenant sa partie de Tomb Raider, les lieux, les obstacles et l’objectif de notre avatar n’auront absolument pas changé, et le nombre de chemins par lesquels atteindre cet objectif restera le même.
On voit mal dès lors où est l’invention et en quoi la chose diffère de l’expérience cinématographique : revoir un film, c’est en effet revoir le même enchainement de mouvements. La seule différence entre le film et le jeu vidéo résiderait alors dans ce que le jeu propose trois ou quatre scenarii différents, à la manière d’un « livre dont vous êtes le héros ». Quoi qu’il en soit, vu sous cet angle, ce que Vial appelle « principe de réversibilité » semble a priori difficilement réductible au virtuel numérique.
Mais qu’appelle-t-il vraiment « revenir en arrière » ? Il ne s’agit pas seulement de recommencer, « revenir en arrière », c’est revenir dans le passé. On peut certes refaire une partie de réussite, tout comme on peut essayer de courir le 100 mètres en moins de dix secondes plusieurs fois d’affilée, mais on ne peut pas refaire la même exacte tentative, celle que l’on a échouée, en repartant de l’instant passé où l’on avait élancé son corps sur la piste de course. C’est cela-même qui, d’après Vial, fait de la réversibilité numérique une nouveauté.
Cependant il a tort de supposer que l’avatar numérique et le monde virtuel sont soumis à un temps différent. Prenons un exemple et disons que j’enregistre mon progrès dans le jeu vidéo ; disons que sur la ligne menant de A1 à A10, je suis à A6. Continuant sa course, mon avatar tombe dans un précipice en A7. Je décide alors de reprendre le jeu à mon point de sauvegarde en A6. D’après Vial, je repars alors dans le passé. Nous voyons très bien qu’il n’en est rien. Il n’y a rien de tel qu’une temporalité propre à mon avatar. En reprenant ma partie en A6, mon avatar sera le même qu’à sa chute en A7, il n’aura ni vieilli ni rajeuni, et le monde virtuel n’aura pas changé. On peut le voir en agissant autrement : disons qu’avant de tomber dans le précipice en A7, je fais demi-tour et je retourne en A6, pour ensuite me retourner et repartir vers A7, cela revient au même : le monde et l’avatar ne changent pas, c’est le lieu qui change. En vérité, lorsque je reprends ma partie en A6 après une chute, je ne saute pas dans le temps, je saute dans l’espace. La réversibilité numérique, que Vial entend temporelle, n’est en réalité qu’une téléportation virtuelle de mon avatar vers un lieu plus reculé sur son trajet. Entre ma chute et la reprise de la partie, l’avatar n’a fait que transiter spatialement tandis que la différence temporelle entre A7 et A6, entre la mort et la résurrection de mon avatar, n’a affecté que moi-même, le joueur. Ainsi, en réessayant, je n’ai pas reproduit l’exacte même tentative que celle qui avait échoué : j’en ai produit une nouvelle, et entretemps, mon expérience des obstacles dans le jeu s’est enrichie, ce qui veut dire que je vais sans doute être plus à même de dépasser l’obstacle en A7. C’est donc sur un présupposé erroné (celui d’après lequel il existe une temporalité virtuelle) que Vial bâtit son principe de réversibilité.
Supposons cependant qu’il désigne autre chose et qu’il vise plutôt les possibilités offertes par un autre type de jeu : les jeux de rôle en ligne, comme le très connu World of Warcraft. Ce type de jeu présente la particularité de déroger à un principe commun à la plupart des jeux vidéo antérieurs : il ne s’agit plus de gagner le jeu. Certes, terminer un jeu représentait auparavant une motivation pour le joueur et une rentabilité pour l’industrie : une fois le jeu gagné, on se lassait et on pouvait en acheter un autre. Avec les jeux de rôle en ligne, les choses ont changé : on ne cherche plus à gagner le jeu, mais à gagner de l’expérience, dans le jeu. On remporte des batailles, on forme des équipes, on mène des quêtes à terme afin d’améliorer le niveau d’expérience, c’est-à-dire de valeur, de l’avatar que l’on s’est forgé dans un monde virtuel en trois dimensions. Notons au passage que la chose n’est pas limitée à des mondes fantastiques comme ceux de World of Warcraft, mais s’étend aussi à des mondes plus réalistes, comme avec la franchise GTA, connue pour l’ultraviolence et l’immoralisme qui la caractérisent30. Dans ce type d’environnement, il ne s’agit plus d’essayer encore, mais plutôt d’essayer autre chose. Si c’est là ce dont nous parle en fait Vial, alors c’est qu’il nous présente comme fondamentalement nouvelle cette possibilité d’essayer autre chose, qui nous laisse libre, dans le jeu, de faire à peu près ce que bon nous semble (on peut par exemple passer son temps à cogner des prostituées dans GTA, ce qui rapporte de l’argent et de la réputation au sein des gangs). On ne se contente plus de laisser au joueur la possibilité d’enchainer les mouvements nécessaires pour gagner à l’allure de son choix ; on ne laisse pas seulement au joueur le choix entre deux ou trois voies différentes par lesquelles il pourra atteindre son but ; on ne lui laisse pas non plus seulement la possibilité de recommencer la partie depuis un point de sauvegarde. Non, le joueur est laissé libre de « vivre sa vie » comme dirait Godard : il lui est toujours possible de terminer le jeu (c’est une option qu’on le laisse libre de choisir), mais il peut aussi faire tout ce qui lui semble divertissant ou enrichissant : discuter avec d’autres joueurs, améliorer son expérience, échanger des artefacts avec d’autres joueurs, laisser libre cours à ses pulsions, se balader, etc.
Avec ce type de jeu, la comparaison avec le cinéma semble moins obscure : le jeu n’amène plus de A à B, comme le cinéma, mais permet de tracer soi-même la carte de son parcours, lequel peut ne jamais aboutir à B. Malgré cela, l’opposition du jeu au cinéma ne tient pas parce qu’elle ignore le sujet réel de l’opération de projection (le spectateur ou le joueur) pour ne s’intéresser qu’à une hypothétique ontophanie sans point de vue. Certes, les images du film seront diffusées dans le même ordre alors que l’ordre des images du jeu vidéo variera avec chaque nouvelle partie. Cependant, ni le film ni le jeu, en tant qu’objets techniques ne seront modifiés par leur déroulement, ce qui changera, ce sera le joueur, et le spectateur : en voyant un film pour la seconde fois, on ne le verra pas de la même manière, on ne verra pas les mêmes images, et de même un jeu. La réversibilité, c’est ce qui supposerait que le joueur, revenant en arrière, soit tout aussi remis à zéro que son avatar. Or, loin de là, la reprise du jeu s’accompagne d’un enrichissement du joueur, dont les capacités, reposant sur ses rétentions, seront grossies de ses précédentes expériences, c’est-à-dire de nouvelles rétentions primaires et secondaires. Qui plus est, ce type de jeu n’échappe pas non plus à l’inanité de l’argument du revenir en arrière : si mon avatar meurt dans un jeu non-connecté, la reprise de la partie n’occasionnera pas un voyage temporel mais plutôt un déplacement spatial. Si mon avatar meurt dans un jeu connecté, le voyage temporel sera tout autant impossible : il impliquerait que tous les autres joueurs connectés me suivent dans le passé, ce qui est absurde. On voit bien que c’est sur une confusion entre déplacement spatial et déplacement temporel que Vial bâtit son principe ontophanique de réversibilité. Ainsi nous dit-il que ce principe
a contribué à entretenir l’idée, sous couvert de virtuel, que les mondes numériques n’étaient pas tout à fait réels. Car l’irréversibilité n’est pas un comportement naturel, i.e. conforme aux lois de la physique. Rien, dans l’univers, n’est réversible. Sauf le phénomène numérique [qui], n’en déplaise aux rêveurs, est une réalité physique objective, car c’est une suite de 0 et de 1 électroniquement exécutés sur une puce de silicium.31
S’imaginant échapper à la métaphysique de l’irréel, Vial tombe donc la tête la première dans une illusion de dépassement paradoxal des lois de la physique. Si rien n’est irréversible d’après les lois de la physique, et si le virtuel numérique dépend de la matérialité de machines hypomnésiques, tout autant que de lois physiques propres, simulées mais bien réelles, alors comment prétendre qu’il puisse échapper à l’irréversibilité ? S’enfonçant dans ce gouffre, Vial y voit une possibilité offerte d’échapper à la nécessité :
Nous ne sommes pas habitués à ce que les choses puissent être à ce point contingentes. Nous sommes plutôt habitués à traiter avec une part irréductible de nécessité. Certaines choses, les stoïciens nous l’avaient appris, ne dépendent pas de nous et, par conséquent, ne peuvent pas être autrement qu’elles sont. Mais, dans les mondes numériques, le stoïcisme ne tient pas : certes, les choses sont ce qu’elles sont (elles ont même leur propre déterminisme), mais elles peuvent à chaque instant être autre chose que ce qu’elles sont, parce qu’elles sont réversibles.32
Nous l’avons vu, dans le jeu vidéo, cette proposition paradoxale ne tient pas : les choses ne peuvent pas être autres que ce qu’elles sont du fait d’une prétendue réversibilité : si je reprends une partie et me dirige du point A6 au point A7 différemment, je ne transforme pas ce qui est en autre chose, je produis quelque chose de nouveau. Ce qui fut, c’est-à-dire mon premier trajet de A6 à A7, n’est pas transformé. C’est un nouveau trajet qui est produit. Car je ne revis pas le même trajet : je n’ai pas fait de bond dans le passé, j’ai simplement été ramené au début de mon trajet, spatialement, et je repars dans la même direction.
Croyant empêcher l’accès du numérique aux stoïciens, Vial semble plutôt se faire leur porte-parole lorsqu’il nous dit que le virtuel numérique est soumis à un déterminisme, au sein duquel « les choses peuvent à chaque instant être autre chose que ce qu’elles sont ». Cicéron ne dit rien d’autre, dans son De Fato, où il expose le fatalisme de Chrysippe et sa théorie des causes, laquelle, pour le dire avec les mots de Gilles Deleuze, « [affirme] le destin, mais [nie] la nécessité »33. Il y a bien, chez les stoïciens, un déterminisme dans la cause destinale corporelle, mais ce que Deleuze appelle quasi-causalité, c’est-à-dire la cause incorporelle de l’acquiescement ou du refus du destin, c’est ce qui, sans le créer, change le réel tel qu’il nous apparait. En somme, la remarque de Vial sur le stoïcisme reprend les mêmes critiques qui furent adressées à Chrysippe des siècles durant, au mépris des réponses que le scolarque leur avait apportées.
Les stoïciens disaient en effet que certaines choses ne dépendent pas de nous, et Vial voudrait leur donner tort en nous attribuant la possibilité de voyager dans le temps, oubliant en cela qu’en dernière instance, nos avatars numériques dépendent des mêmes lois physiques que nous, qu’ils ne sont pas soumis à un temps différent, qu’ils dépendent d’une matérialité. Etrange oubli, d’ailleurs, dans la mesure où le philosophe semble par ailleurs tout à fait conscient de ces dépendances :
Il suffit d’une panne de courant électrique pour que tout ce qui n’avait pas été enregistré en mémoire disparaisse littéralement du champ de la réalité, et cette fois, irréversiblement (ce qui montre que le phénomène numérique, tout réversible qu’il est, est néanmoins rattaché à l’irréversibilité fondamentale du monde physique).34
Affirmation qui contredit fermement ce qu’il affirmait quelques pages plus haut :
Au pays de la matière calculée, il est toujours possible d’annuler. Ctrl-Z ou Pomme-Z. Annuler-Refaire (Undo-Redo). Telle est la double action la plus célèbre de l’informatique, celle à laquelle nous sommes déjà tellement accoutumés que nous regrettons parfois, comme par réflexe, de ne pas pouvoir en jouir dans le monde physique classique.35
- La néantisation du virtuel
Etendre le principe de réversibilité à la fonction Annuler-Refaire ne le rend pas plus viable : disons que je tape le mot « réversibilité » au clavier, puis que j’appuie sur les touches Ctrl et Z en même temps : le mot s’efface. Alors de deux choses l’une : soit je tape tout de suite sur les touches Ctrl et Y et le mot réapparaîtra tel quel : ce n’est pas là de la réversibilité, mais de la rétention. Le mot a été conservé en mémoire et il est re-productible tel quel. Soit je tape un autre mot. Dans ce cas, j’aurai beau revenir en arrière, je ne retrouverai pas le premier mot tapé. La rétention informatique et sa finitude sont ici perdues de vue en faveur du fantasme de la sauvegarde infinie et de la possibilité de tout annuler, c’est-à-dire annuler le vécu rétentionnel (pour revenir dans le passé sans mémoire).
Le phénomène numérique n’échappe pas aux lois de la physique. Stéphane Vial l’affirme et pourtant le nie. L’irréversibilité ne peut s’évanouir que dans un monde dépourvu de nécessité et de causalité, comme celui de la fantaisie. Si j’écrase une puce de silicium sous mon pied, je ne pourrai pas la retrouver comme neuve car il n’existe pas de fonction Ctrl-Z dans la réalité tangible : le voyage dans le temps n’existe pas en ce sens pratique qui consisterait à en faire un voyage personnel et exclusif où l’on reviendrait en arrière dans son propre corps, sans que rien ne soit affecté autour de soi par ce retour sinon peut-être (Vial n’est pas clair là-dessus) sa propre expérience. Et la même chose vaut pour le virtuel, qui n’est pas dans un autre régime de réalité et qui dépend des lois de la physique. Par contre, si je décidais, dans mon imagination, de revivre le moment où j’ai écrasé la puce de silicium, et si alors je me retrouvais au moment où mon pied s’apprête à l’écraser, la puce serait reconstituée ponctuellement : cela serait possible dans la seule mesure où mon imagination n’est pas soumise aux lois de la physique. Pour autant, je ne voyage pas davantage dans le temps : mon imagination ne me renvoie pas dans le passé, elle me permet d’imaginer un scénario différent. La fantaisie, en somme, me permet d’imaginer un renversement de situation au niveau physique, mais pas de le manifester tangiblement, pas plus qu’elle ne me permet de voyager dans le temps : la réversibilité, au sens où l’entend Vial, n’existe pas même là.
Aveugle aux contresens inhérents à son concept de réversibilité, Vial présente alors dans la foulée un autre de ses principes ontophaniques : la destructibilité du phénomène numérique. Voici comment il le présente :
En principe, du point de vue de la science, il n’existe aucun matériau capable, dans sa réalité physique, de disparaître […] sans laisser de traces, en s’effaçant purement et simplement du champ de la réalité. Nous l’avons tous appris à l’école : l’eau portée à ébullition ne disparaît pas, elle se transforme en vapeur. Même le texte que j’écris à la craie au tableau noir laisse des traces : si je l’efface avec la brosse, il se transforme en poussière déposée sur mes doigts. À la suite d’Anaxagore de Clazomènes, Lavoisier en avait d’ailleurs fait un principe fondamental de la science physique : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme! ». […] À l’heure numérique, ce principe n’est plus vrai.36
Découlant de son analyse de la fonction Annuler, le principe de destructibilité prétend encore une fois échapper aux lois de la physique. Or, les mêmes critiques reviennent. D’abord, on rétorquera qu’en apparence, d’autres choses semblent susceptibles d’être néantisées : le souvenir, par exemple. En effet, je ne me souviens plus de la première année de ma vie. Je ne me souviens plus non plus où j’étais le 3 septembre 1998 à 15h. Pourtant, mon appareil psychique a bien dû retenir ces choses : où sont-elles passées ? N’ont-elles pas purement et simplement disparu ? Comme le disaient Derrida et Stiegler dans Echographies de la télévision :
La mort n’est autre qu’un effacement total de mémoire.37
Mais en vérité, cet effacement n’est pas, je le sais, une néantisation : les souvenirs ne sont pas des incorporels indépendants de la matière : la mémoire dépend de connexions neuronales, c’est-à-dire de l’organologie somato-psychique. Si mes souvenirs me semblent avoir disparu, c’est tout simplement parce que les connexions neuronales qui les maintenaient ont été rompues et que d’autres connexions se sont peut-être formées à leur place. De même, après la mort, la mémoire n’est pas effacée, mais empêchée : il n’y a plus d’accès privilégié aux connexions neuronales et tandis que le corps se décompose, ces connexions se transforment avec lui. Les phénomènes numériques relèvent eux aussi d’un mécanisme rétentionnel, lequel ne les néantise pas, mais les transforme en autre chose. C’est ce que ne voit pas Vial qui écrit :
Lorsque, tranquillement installé devant mon écran, je « supprime » un fichier de mon ordinateur ou de mon disque dur externe, que se passe-t-il ? Où est passé le fichier supprimé ? Est-il transformé ou bien a-t-il disparu ? Les sceptiques diront qu’il se transforme parce qu’il se déplace dans la Corbeille du système. Certes. Mais si je vide la Corbeille ? Que devient-il ? Est-il évacué dans les canalisations ? Où est la fumée ? Où sont les cendres ? Inutile de chercher des traces : cette fois, le fichier a réellement disparu. Il ne s’est pas transformé, il n’a pas changé d’état. Il faut bien mesurer l’événement dans toute sa puissance ontologique : il a glissé de l’être vers le néant !38
Vial oublie au passage que le fichier qu’il vient de supprimer n’est, aux « yeux » de son ordinateur, qu’une série de 0 et de 1. Rien d’autre. Or, comment fonctionne la rétention informatique ? Qu’il s’agisse de mémoire vive (celle qui stocke temporairement, à la manière d’un organe de rétention primaire) ou de mémoire morte (celle qui stocke indéfiniment, à la manière d’un organe de rétention secondaire), un « souvenir » informatique est conservé par l’inscription de signaux magnétiques binaires sur un disque, à l’aide d’une tête de lecture/écriture. Effacer un fichier, c’est donc tout simplement modifier en écriture les signaux magnétiques binaires : par exemple écrire 0 à la place de 1. Il n’y a pas d’effacement du fichier, il y a transformation de l’espace rétentionnel sur le disque de mémoire : là où le fichier était retenu, il y aura une inscription différente : celle correspondant à un espace disponible.
c) En finir avec la finitude :
Derrière ces deux principes se tient un rêve, celui d’un élargissement des capacités physiques et d’un dépassement de la finitude physique et rétentionnelle de l’individu. Ces rêves trouvent leurs sources comme leurs prolongements dans la science-fiction. On ne compte plus les histoires de surhommes, qu’ils soient mutants, comme Spiderman, riches industriels technophiles, comme Batman, ou encore symbiotes, cyborgs, pilotes d’avatars… La finitude physique est sans cesse repoussée par la fiction, comme le montre le mythe populaire consistant à attribuer à Albert Einstein l’idée que seules 10% de nos capacités cérébrales seraient actives. Le cinéma n’est pas en reste, où Luc Besson renchérit sur ce mythe et nous montre ce mois-ci, dans Lucy, une Scarlett Johansson soumise à une drogue lui permettant d’utiliser 100% de ses capacités cérébrales, ce qui lui permet bien sûr de voyager dans le temps, d’ignorer la douleur, de déplacer les objets par la pensée, etc. Au cinéma, toujours, le film Transcendence, avec Johnny Depp, nous montrait il y a deux mois une conscience uploadée dans un ordinateur. Ce que nous dépeint la fiction, c’est ce désir d’augmentation de la mémoire et des capacités physiques en général.
Il ne s’agit pas d’immatérialité mais de ce que Stéphane Vial appelle « fluidité » pour forger un autre principe ontophanique : selon lui, le « phénomène numérique est thaumaturgique » en ceci qu’il est débarrassé de toute pesanteur pour accéder à une sorte d’éther miraculeux de rapidité et de fluidité.
Et si détachement il y a, plutôt que d’un détachement d’avec le corps, c’est d’un détachement d’avec la résistance des choses qu’il s’agit. Le phénomène numérique nous a libéré d’une part importante de la capacité de la réalité à nous résister — encore qu’il reste à évaluer dans quelle mesure cette résistance n’est pas liée au corps, ou du moins à une certaine forme de la matérialité. 39
Dans l’énoncé-même de ce principe se trouve la clé de l’illusion qu’il représente. En effet, le phénomène numérique dépend tout entier de matérialité, nous l’avons dit à maintes reprises. Vial voudrait que l’informatiquement simulé nous permette d’accéder magiquement à des éléments infiniment distants de manière infiniment rapide et ne se rend pas compte qu’il confond les possibilités du virtuel numérique, c’est-à-dire de la simulation, avec celles du virtuel philosophique, c’est-à-dire de la consistance. L’informatiquement simulé manifeste des éléments dans les limites finies permises par la technologie, c’est-à-dire par la théorie matérialisée qui le rend possible. La rapidité technologique n’est pas un miracle d’échappement à la résistance des choses mais une autre manière de composer avec cette résistance, toujours dans le cadre général des lois de la physique.
Par ailleurs, toute dépendante qu’elle est de la matérialité, la transindividuation, n’a pas attendu le protocole USB 3 ou la 5G pour manifester cette fluidité que Vial voudrait neuve et essentiellement informatique : lorsque j’use le mot « révolution », j’accède au transindividuel, que je peux moi-même individuer : aucune frontière spatio-temporelle ne m’empêche d’accéder au même matériau de base que celui qu’usa Robespierre.
Le principe de fluidité de Vial rejoint bien le rêve d’augmentation formulé par la fiction. Cependant ce rêve doit s’accompagner d’une pharmacologie qui, absente de la théorie ontophanique de Stéphane Vial, ne manque pas dans le même temps de se manifester dans la fiction. Le cinéma de science-fiction, pour ne parler que de lui, tend à rappeler aux spectateurs, que derrière un pharmakon rêvé se tiennent toujours la conséquence, le risque et la responsabilité. De ce point de vue, les films de super-héros sont peut-être, en tout cas pour une large majorité d’entre eux, les films de science-fiction les moins oublieux de l’éthique. Certes la conscience et les dilemmes moraux d’un Spiderman ou d’un Batman ne volent pas toujours très haut, contrairement à eux, mais au moins ces super-humains se posent la question de leur augmentation plutôt que de simplement basculer dans une idéologie amoraliste et libertarienne promouvant le surhomme sans en faire la moindre critique, comme tend à le faire un autre cinéma Hollywoodien, celui de Quentin Tarantino et de ses épigones, mais aussi le cinéma d’horreur esthétisant tel le récent Stoker, de Park-Chan Wook ou le You’re next d’Adam Wingard, pour ne citer que ceux-là.
Quoi qu’il en soit, les rêves de Stéphane Vial, qui sont partagés par beaucoup, découlent d’une confusion générale sur la nature du virtuel numérique, et tout à la fois y conduisent. Cette confusion peut amener à croire ou à faire croire que l’on peut vaincre le sommeil afin d’imposer un régime de consommation 24/7 total et c’est ce que combat Jonathan Crary. Elle peut même pousser à croire ou à faire croire que l’on peut vaincre la mort, afin de se convaincre avant tout débat que les questions de bioéthique sont caduques face au rêve de l’immortalité, et c’est l’illusion qu’entretient La mort de la mort, le récent ouvrage de Laurent Alexandre.
III Thérapie
Contre une telle confusion sur la nature du virtuel numérique doivent s’élaborer des thérapeutiques théoriques, académiques, technologiques et politiques. Celles-ci me semblent devoir s’accorder sur un certain nombre de propositions, à savoir :
-
Premièrement, que le virtuel numérique n’est ni un outre-monde ni un miracle ni une magie.
-
Deuxièmement, que le virtuel, qu’il soit philosophique, phénoménotechnique ou informatique, est toujours une réalité.
-
Troisièmement, que toute réalité appelle la réitération de l’interprétation et du jugement.
- Et quatrièmement, qu’en tant que réalité, le virtuel n’échappe ni aux lois de la nature, ni aux lois des hommes.
Du point de vue théorique, une thérapie générale devrait se constituer autour du projet global d’une Critique du numérique, au sens kantien, laquelle devrait s’assumer comme une épistémologie organologique et pharmacologique et de ce fait s’accompagner d’une éthique. Un tel projet ne peut à mon sens s’envisager que de manière transdisciplinaire et contributive. Ma propre contribution à ce projet sera, dans un premier temps, de tenter d’approcher et de revisiter les reproches adressés par Simondon à la cybernétique et à la théorie de l’information, en passant par le souvenir pur de Bergson, le virtuel de Deleuze, les préhensions de Whitehead, les rétentions de Husserl et la conception post-cybernétique proposée par Goodman et Parisi dans un article40 très intéressant sur la mémoire que m’a tout récemment fait lire Anaïs Nony, tout cela à la lumière des analyses de David Bates.
Du point de vue académique, Stéphane Vial a tout à fait raison, lorsqu’il mentionne le bug informatique, d’écrire : « Il manque dans nos écoles une éducation à la versatilité numérique. »41 Il est absolument essentiel que les enseignements primaire et secondaire adoptent les outils numériques et les incorporent à leurs programmes. Par là, il ne s’agit bien sûr pas de distribuer des tablettes numériques aux enfants, mais bien plutôt de repenser l’enseignement de ce qu’au début des années 60, on a appelé la « technologie ». Les enfants et les adolescents doivent certes apprendre à manipuler et à bricoler sur des outils numériques, mais il est tout aussi nécessaire qu’ils comprennent ce qui se cache derrière l’interface : il faudrait ainsi proposer dès le collège des introductions à la programmation et l’algorithmique, aux théories du calcul et de l’électronique, au design et à la structuration de l’information. Cependant, de tels enseignements seraient caducs s’ils n’étaient pas mis en étroite relation avec l’enseignement classique des langues et des sciences et avec un enseignement civique bien différent des classes d’éducation civique se contentant de passer en revue les institutions. Être citoyen, ça n’est pas seulement savoir dans quel système politique on évolue, c’est aussi savoir en quoi ce système politique peut être critiqué, comment il doit être interprété, et comment il peut être transformé. Ce que l’on devrait enseigner en guise de citoyenneté, ce n’est pas seulement la norme politique, mais bien plutôt la nécessité de la réitération de l’interprétation et du jugement de cette norme et de toute norme, c’est-à-dire ce que j’appelle la déontogenèse. Une classe d’enseignement citoyen, en somme, devrait être une classe de préparation à l’herméneutique et à la pharmacologie. Loin de revenir à l’époque des cours de morale, il s’agirait plutôt d’apprendre à (se) faire écran, à s’envisager, non pas comme de simple spectateurs, consommateurs d’images, mais plutôt comme des projectionnistes ne voyant que grâce à leur capacité à appréhender les écrans qui abondent, et en tant que l’on ne rêve et donc n’agit que parce que l’on peut se projeter. Ces classes civiques devraient enseigner à se situer en critiques permanents, et à se comprendre comme projections ambulantes, en représentation dans chacun de ses actes. L’enseignement civique, l’enseignement des langues et l’enseignement des sciences devraient ainsi être couplés à l’enseignement numérique : un élève devrait travailler avec le web, avec la bureautique, avec les réseaux sociaux, et avec des technologies d’annotation et de commentaire, et ce au moins dès le lycée. Ces technologies d’annotation et cette approche herméneutique et transdisciplinaire devraient bien évidemment être adoptées par l’enseignement supérieur afin de permettre aux universitaires et aux jeunes chercheurs d’envisager une recherche contributive mise en réseau.
C’est ce que l’Institut de Recherche et d’Innovation essaie de proposer, d’un point de vue technologique, à travers un dialogue avec le W3C autour de la question des standards du web et afin que le web sémantique soit aussi un web herméneutique. C’est aussi la question générale qui sera abordée au cours du séminaire « Muséologie, Muséographie » de l’IRI en 2014/2015, dont le titre sera « Enseignement supérieur et recherche à l’ère du numérique ». Rappelons au passage que le développement de technologies herméneutiques de transindividuation, à l’IRI, a aussi connu une accélération dans le domaine de l’enseignement, grâce à la recherche contributive organisée ces dix derniers mois autour de pharmakon.fr et dont les résultats ont notamment été présentés en juin dernier, durant le festival Futur en Seine42. Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à cette recherche, laquelle sera prolongée en 2015, et à laquelle contribueront aussi des chercheurs-pilotes, comme Paolo Vignola et Daniel Ross, qui créeront en Equateur une équipe travaillant sur ces thèmes.
D’un point de vue politique, enfin, la position d’Ars Industrialis est d’affirmer le danger de l’automatisation généralisée et de promouvoir en réponse une économie pharmacologique de la contribution et un régime social d’intermittence. L’intermittence, ça n’est pas seulement celle des intermittents du spectacle. Comme le rappelait récemment Bernard au festival d’Avignon43, il s’agit de notre condition : nous ne pouvons pas être toujours en acte. Nous ne pouvons pas être toujours éveillés. Nous ne pouvons pas être toujours en vie. Et nous ne pouvons pas être toujours noétiques. C’est pourquoi il nous faut nous souvenir de la nécessité de ré-interpréter. De ce point de vue, il faudrait mobiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur la nécessité d’une calendarité44, c’est-à-dire la réintroduction de temps « off » dans la vie publique, mais aussi la recapitalisation sociale du cyclique, au sens où Paolo Vignola parle de social. Enfin, plus personnellement, je soutiens que d’un point de vue systémique, il faudrait envisager l’explicitation et la défense de ce que j’appelle une approche déontogénétique des processus de transindividuation,
1Stéphane Vial, Contre le virtuel : une déconstruction, in Les territoires du virtuel, l’Harmattan, 2014 pp. 178-179
2Stéphane Vial, La structure de la révolution numérique, Thèse de doctorat en philosophie, Paris Descartes, 2012, p. 183
3Contre le virtuel : une déconstruction, p. 179
4Gilles Gaston-Granger (1995), Le probable, le possible et le virtuel : essai sur le rôle du non-actuel dans la pensée objective, Odile Jacob, p. 13
5Gilles Deleuze, Différence et Répétition, PUF, 1968, pp. 269-274
6Edmund Husserl, L’origine de la géométrie, PUF, Epiméthée, Paris, 1962
7La structure de la révolution numérique, p. 184
8Gaston Bachelard, Le Matérialisme Rationnel, p. 231
9La structure de la révolution numérique, pp. 184-185
10Contre le virtuel : une déconstruction, p. 181
11Ibid.
12C’est-à-dire lorsqu’il utilise un ordinateur puisqu’aujourd’hui on distingue mal un ordinateur d’une connexion Internet.
13Quéau, Ph. (1993). Le virtuel : vertus et vertiges. Seyssel : Champ Vallon, collection « Milieux », p. 18.
14Contre le virtuel : une déconstruction, p. 182
15Jonathan Crary, 24/7, Le capitalisme à l’assaut du sommeil, La Découverte, Paris, 2014, p. 60 (je souligne)
16Contre le virtuel : une déconstruction, p. 184
17Lambert Wiesing, Réalité virtuelle : l’ajustement de l’image et de l’imagination, in Trivium [En ligne], 1 | 2008 : http://trivium.revues.org/288
18Ibid. (je souligne)
19Grégoire Chamayou, Théorie du Drone, La Fabrique, Paris, 2013, p. 131
20Ibid, p. 111
2124/7, p. 45
22Théorie du drone, p. 153
23Contre le virtuel : une déconstruction, pp. 186-187
24Ibid. p. 185
2524/7, p. 59
26Quéau, Le virtuel : vertus et vertiges, p. 30
27Ibid, p.45
28La structure de la révolution numérique, p. 237 (je souligne)
29La structure de la révolution numérique, p. 242 (je souligne)
30On y joue un gangster et on gagne en expérience en commettant des délits et des crimes.
31Ibid.
32Ibid, p. 244
33Gilles Deleuze, Logique du sens, Minuit, 1969, Paris, p. 198
34La structure de la révolution numérique, p. 245-246
35Ibid, p. 242
36Ibid, p.246
37Bernard Stiegler, Echographie de la télévision, avec Jacques Derrida, chap. III, « l’image discrète », Galilée, 1996
38La structure de la révolution numérique, p. 247
39Ibid, p. 252
40Steve Goodman and Luciana Parisi, Machines of Memory, in “Memory : Histories, theories, debates”, Fordham University Press, New York, 2010
41La structure de la révolution numérique, p. 232
42Cf. http://ldt.iri.centrepompidou.fr/ldtplatform/ldt/front/player/176d2276-fac1-11e3-ba95-00145ea4a2be/
43Cf. http://arsindustrialis.org/les-intermittences-de-l%E2%80%99%C3%A2me-la-fonction-no%C3%A9tique-du-th%C3%A9%C3%A2tre-et-la-situation-politique-pr%C3%A9sente
44A ce sujet, je renvoie à l’article « Calendarité et cardinalité » sur le blog de Christian Fauré : http://www.christian-faure.net/2006/07/02/calendarite-et-cardinalite/